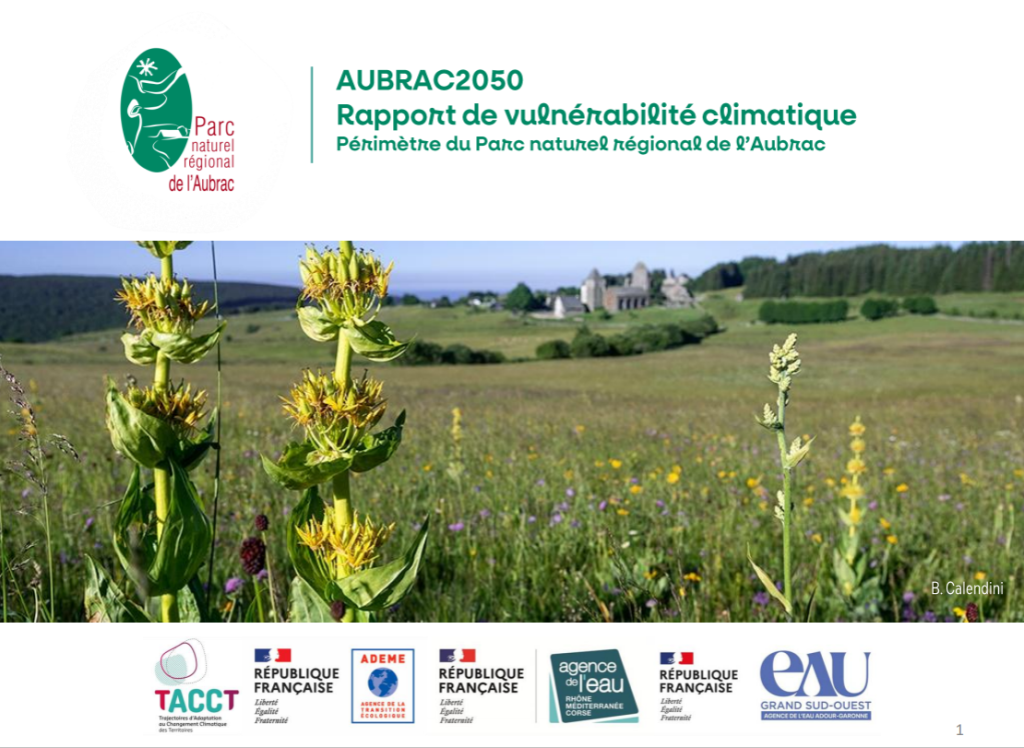Le diagnostic du Programme de transition énergétique et climatique de l’Aubrac a été délivré à la fin de l’année 2021. Lors du plan d’action provisoire existant, il a été soulévé la nécessité d’avoir un outil d’aide à la décision pour le territoire sur l’adaptation au changement climatique. La méthodologie TACCT proposée par l’ADEME, pour « Trajectoire d’adaptation au changement climatique des territoires », permettra la mise en œuvre de cet outil. De plus, elle permettra, d’actualiser et d’améliorer le diagnostic climat finalisé en 2021.
Le Parc naturel régional de l’Aubrac fait partie des 11 territoires d’Occitanie accompagnés par l’Ademe.
Un outil transversal pour l'adaptation des territoires au changement climatique
Des démarches sur l’adaptation au changement climatique se réalisent déjà sur le territoire. L’exemple le plus important est celui de l’outil AP3C développée par le SIDAM. Néanmoins, aucun de ces outils permet de traiter la problématique d’une manière non sectorielle ni thématisée.
- La méthodologie TACCT prévoit la formation d’un Comité de pilotage composé d’élus qui pourront bénéficier d’un programme de formation et d’acculturation aux enjeux du changement climatique (Fresques du Climat, ClimatStory, visites de terrain,…) ainsi que des ateliers de concertation. Les techniciens des collectivités ainsi que les associations du territoire pourront également participer à ces temps de formation et de concertation.
- Un diagnostic sur les aléas climatiques et la vulnérabilité du territoire face au changement climatique seront étudiés et territorialisés. Exemples d’indicateurs étudiées : changement de la température de l’air, changement de la pluviométrie, nb de jours de gel, enneigement, épisodes caniculaires…
- Ces données seront diffusés via la création d’un “Observatoire du changement climatique en Aubrac”. Cette information permettra d’alimenter les travaux de rédaction des documents d’urbanisme des collectivités du territoire de manière à mieux prendre en compte les enjeux du changement climatique dans les politiques d’aménagement local.
- Le Parc de l’Aubrac, composé d’une diversité des ingénieurs et techniciens qui travaillent sur des thématiques différentes, se positionne comme un des organismes locaaux de référence sur la thématique du changement climatique.

Le programme TACCT bénéficiera à l’ensemble des communes du Parc ainsi qu’à celles des Communautés de communes de :
- Aubrac Carladez et Viadène
- Saint Flour Communauté,
- Hautes Terres de l’Aubrac,
- Terres d’Apcher Margeride Aubrac,
- Gévaudan,
- Aubrac Lot Causse Tarn.
Les acteurs mobilisés
- Les régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes,
- Les départements et leurs services : Aveyron, Cantal et Lozère, le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Lozère, les Syndicats d’énergies de l’Aveyron et du Cantal.
- Les services de l’Etat : DREAL Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, DDT de l’Aveyron, du Cantal et de la Lozère,
- Les élus du Parc : Commissions Energie, Agricole et Tourisme.
- Les Chambres consulaires : Chambres d’Agriculture, Chambres des métiers et Chambres de commerce et d’industrie d’Aveyron, du Cantal et de la Lozère,
- Les Communautés de communes : Aubrac Carladez Viadène, Hautes terres d’Aubrac, Gévaudan, Terre d’Apcher Margeride Aubrac, Saint Flour Communauté, Aubrac Lot Causse Tarn,
- Les Pôles d’Équilibre Territorial et Rural du Gévaudan et du Haut Rouergue,
- Acteurs de l’Agriculture : Le Groupement de Valorisation Agricole Caldagues Aubrac, l’UPRA Aubrac, le Comité de développement Agricole du Nord Aveyron, le Service interdépartemental pour l’animation du Massif central et la Conférence des Présidents des organisations Agricoles du Massif central, la Fédération des Coopératives d’utilisation de machines agricoles et l’INRAE.
- Acteurs de la biodiversité : Agence Régionale de la Biodiversité, Conservatoire des Espaces Naturels, Conservatoire Botanique, Office français de la Biodiversité.
- Acteurs de la forêt : l’Office national des forêts, le Centre régional de la propriété forestière, le Syndicat des collectivités forestières, Interprofessions du bois, MFR Javols, Francesylva Aveyron, Cantal et Lozère.
- Acteurs de l’eau : Syndicat mixte Lot Dourdou, EDF Hydro Lot-Truyère,
- Acteurs de l’Education : Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de Haute Auvergne et du Haut Rouergue, Réseau d’Éducation à l’Environnement de Lozère.
- Acteurs du Tourisme : Offices de tourisme du territoire, Comités régionaux du Tourisme d’Occitanie et d’Auvergne-Rhône-Alpes, Comités départementaux d’Aveyron, du Cantal et de Lozère.
- Les observatoires : L’Observatoire Régional Climat Energie en Occitanie et l’Observatoire Régional de l’Énergie et des Gaz à Effet de Serre.
- Réseau associatif : CLCV – Association nationale de consommateurs et usagers de l’Aveyron, du Cantal et de la Lozère, Canopée Aveyron, Le Labo d’Aqui, les Amis du Parc, l’Association Agriculture en Aubrac, Arbres, haies, paysages Aveyron, les Foyers ruraux de l’Aveyron, du Cantal et de la Lozère, ADOC-Agir Durablement Olt et Causses,…
- Les financeurs : Agence de l’eau Adour et Garonne, ADEME Occitanie.
- Autres : Agence régionale Énergie Climat Occitanie, Fédération de Chasse, Association de pêche, CEREMA, Réseau d’expertise sur les changements climatiques en Occitanie, Syndicat de la Montagne, Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères
Période
Janvier 2024 – décembre 2025
Financeurs




Documentation
Élus et agents